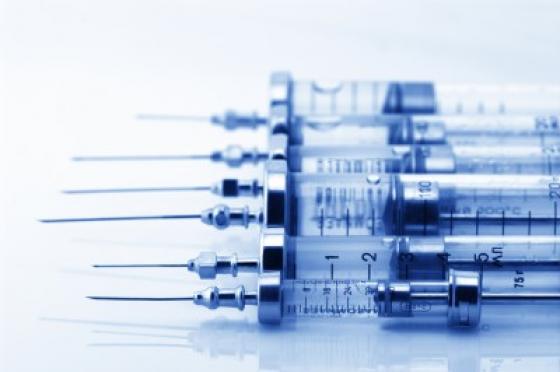Un comité international d’experts dans la prise en charge de l’infection à VIH a été mandaté par l’International Antiviral Society (antérieurement AIDS-USA) pour faire le point sur différents aspects portant sur la recherche, la thérapeutique, les aspects financiers et autres de la maladie, en se basant sur les articles parus sur ces thèmes dans Pub Med et EMBASE entre Janvier 2018 à Aout 2020, le but étant d’actualiser ainsi les recommandations de 2018. Les adultes de plus de 18 ans, à risque ou porteurs d’une infection par VIH étaient ici plus particulièrement ciblés.
Début du traitement le plus rapidement possible
La date de début du traitement n’a guère changé. Il doit être démarré dès que possible après le diagnostic, voire même immédiatement après ou lors de la première visite suivant l’annonce de la séropositivité. En cas d’infection opportuniste, il doit suivre de 2 semaines la date de début du traitement de cette infection. Toutefois, en cas de tuberculose avec un taux de CD4 effondré, à moins de 50/µL, la mise en route doit être différée, dans les 2 à 8 semaines suivant le début du traitement antituberculeux. Il en va de même en cas de méningite tuberculeuse ou cryptococcique. En cas de tuberculose active traitée par rifampicine, le bictegrevir n’est pas recommandé et l’on doit plutôt recourir à une association dolutégravir, éfavirenz ou raltégravir en combinaison à 2 inhibiteurs nucléosidiques transcriptase inverse.
En cas d’utilisation d’un inhibiteur de protéase, la rifabutine doit, dans la mesure du possible, être substituée à la rifampicine. Dans l’hypothèse d’un cancer en évolution, le traitement doit aussi débuter sans délai, en tenant compte cependant des possibles interactions médicamenteuses.
Cette stratégie est dénommée ART rapide, ART immédiat ou ART le jour même. Trois essais cliniques randomisés conduits en Afrique du Sud et en Haïti ont amplement démontré qu’une rapide initiation de l’ART était associée à un taux élevé de suppression virale.
Le protocole ART idéal doit, en théorie, entrainer un taux maximal de suppression du virus, avoir une toxicité réduite, comporter un nombre faible de comprimés à ingérer quotidiennement et comprendre peu d’interactions médicamenteuses. Il peut s’agir d’une combinaison bictegrevir/ ténofovir alafenamide/ emtricitabine, de l’association dolutégravir/ ténofovir ou, avec réserve de dolutégravir/ lamuvidine. De façon générale, le recours à une utilisation préférentielle de dolutégravir, ou de bictegrevir est préconisé du fait de leur grande efficacité, leur tolérance, le nombre faible d’interactions et leur haute barrière à l’apparition de résistances secondaires.
Durant une grossesse, plusieurs protocoles sont disponibles tels atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, dolutégravir, éfavirenz…La combinaison dolutégravir/ténofovir emtricitabine est une option sure quand doit démarrer une grossesse.
Sur un autre plan, la mise en route d’ un ART amène souvent à une prise pondérale, liée à réduction de l’inflammation, du catabolisme et de l’anorexie propre à l’infection par le VIH, pouvant conduire à une obésité patente. A ce jour, on ne peut qu’en informer les patients et leur suggérer de modifier leur alimentation et leur style de vie.
Quand des modifications du traitement sont nécessaires
Bien souvent est posé le problème de savoir quand et comment modifier un traitement, soit dans le but de simplification, soit en cas d’effets toxiques, d’interactions médicamenteuses ou de considérations économiques. Il est alors recommandé de doser la charge virale un mois avant le changement éventuel. Si le malade avait atteint un stade de suppression virale, avec charge nulle, le ténofovir alafénamide ou le ténofovir disoproxil fumarate doivent être maintenus. Chez un patient sous inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (nRTI) avec mutations, le changement vers des molécules exposant à une moindre résistance génétique, de type inhibiteur non nucléosidique (nnRTI)ou raltégravir n’est pas recommandé. En cas de modification rendue nécessaire par un échec thérapeutique (défini par un taux d’ARN viral > 200 copies/mL), il est fondamental de tester au préalable les résistances du virus L’ajout d’une nouvelle molécule au régime antérieur n’est pas recommandé et l’association dolutégravir à 2 nRTI ou à d’un inhibiteur boosté de protéase à 2 nRTI est préférable. Dans l’hypothèse de résistances multisites, de nouvelles molécules sont à utiliser, type fostemsavir ou ibalizumab associés à, au moins, une molécule restée active. L’ajustement peut être aussi le fait de pathologies concomitantes. Lors de la prise de ténofovir disoproxil fumarate peut survenir une tubulopathie proximale obligeant à un changement pour le ténofovir alafénamide ou la combinaison dolutégravir/lamuvidine. En cas de cirrhose, la réduction des enzymes hépatiques cytochrome tend à diminuer le métabolisme de certains antiviraux. Le ténofovir, la lamuvidine, le raltégravir, entre autres, ne nécessitent toutefois pas d’ajustement posologique en cas d’hépatopathie à un stade avancé.
PrEP et PEP
La prévention de l’infection VIH passe par une approche multimodale. Il peut s’agir d’une prophylaxie pré exposition (PrEP) ou post exposition (PEP). La PrEP est recommandée chez tous les sujets à risque. Est alors utilisé le ténofovir disoproxil fumarate / emtricitabine une fois par jour, voire double dose en cas d’homosexualité masculine. Le cabotégravir injectable, toutes les 8 semaines, est proposé pour les hommes agenres ou les femmes transgenres qui ont des rapports sexuels avec des hommes. En préalable doivent être effectués une recherche d’anticorps et une antigénémie VIH ainsi qu’un bilan plus large (créatinémie, diagnostic de l’hépatite B, et si besoin, dépistage d’une gonorrhée, d’une chlamydiose et d’une syphilis). En cours de PrEP, la surveillance doit être régulière, avec notamment recherche itérative des anticorps et antigènes VIH. La PEP est, quant à elle, recommandée idéalement dans les 24, au maximum 72 heures suivant une exposition. Elle doit alors être maintenue 28 jours, comportant un protocole dolutégravir/ bictegravir ou ritonavir/danonavir boosté. Une PEP ne doit pas être mise en route en cas de suspicion de VIH aigu ou primaire en évolution.
Une espérance de vie quasi normale avec des risques de comorbidités
Du fait de l’efficacité des ART, l’espérance de vie des malades VIH+ augmente et se rapproche de celle des patients non VIH. Ils présentent, toutefois, dans leur 5e et 6e décennie, des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de néphropathies chroniques, de troubles cognitifs et mentaux, souvent agravés par une solitude et un isolement social. Une attention particulière doit être alors portée sur la polymédication, le renforcement des activités physiques et les conseils nutritionnels. L’appréciation annuelle de la fonction cognitive est aussi utile, dépassé l’âge de 60 ans.
Le coût des ART est à prendre en considération car intervenant dans le succès thérapeutique. Il varie énormément selon les pays.
Plusieurs stratégies sont possibles pour tenter de le réduire : prise de génériques, quand ils existent, fractionnement des co médicaments, programmes à la fois gouvernementaux et issus de l’industrie pharmaceutique.
Le programme 90-90-90, visant à vaincre l’épidémie d’infection à VIH, a été mis en place en 2014 : il a pour ambition que 90 % de la population VIH connaisse son statut, que 90 % d’entre eux soient traités et que 90 % doivent alors, sous traitement, aboutir à une suppression virale. Hélas, à ce jour, ces objectifs ne sont que partiellement atteints, respectivement à 79 % (67-92 %) quant au diagnostic, à 78 % (69- 82) pour l’accès aux soins et à 86 % (72- 92) pour la suppression de la virémie. L’épidémie de Covid-19 est, également, venue compliquer la situation, avec les mêmes mesures à prendre contre ce nouveau virus, VIH ou non VIH et maintien, non modifié de l’ART.
Cet ensemble de recommandations doit faire l’objet de quelques réserves. Il y a, constamment, des avancées thérapeutiques, notamment en matière d’ART de longue durée d’action préventive ou curative. Les recommandations, ici rapportées, issues de Pub Med et d’Embase ne reflètent pas l’intégralité de la littérature médicale. Elles s’appliquent essentiellement aux pays à moyen ou haut niveau de vie.
Dr Pierre Margent
Saag MS et coll. : Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults. Recommandations 2020 of the International antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2020 ; 324(16):1651-1669. doi: 10.1001/jama.2020.17025.