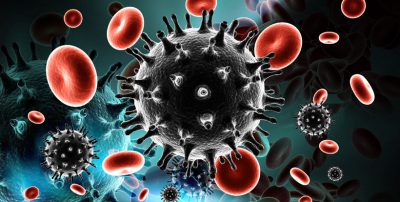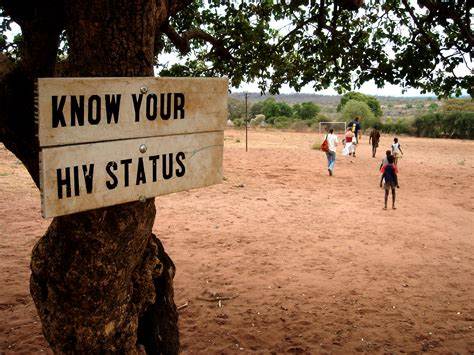Prendre des psychotropes pour performer et décupler ses sensations pendant un rapport sexuel est une pratique « vieille comme le monde ». Mais l’arrivée des drogues de synthèse et leur facilité d’accès ont changé la donne. Addiction, coma, mise en danger de soi ou d’autrui, abus sexuels, dégâts psychologiques… Ce qui n’était qu’un jeu devient un enfer.
Mais ce matin-là, en pleine discussion avec les élèves, le téléphone de Jean-Luc n’arrête pas de sonner. Discrètement, il consulte le message d’un de ses amis : « Christophe a disparu, rappelle-moi d’urgence ! ». Son compagnon ne s’est pas présenté à un salon d’infirmiers où on l’attendait en sa qualité de militant. Malgré les tentatives d’appel, le jeune homme ne donne aucun signe de vie. Alors qu’il est dans le train pour Paris, le téléphone de Jean-Luc sonne. Au bout du fil, un policier. Il faut venir rapidement au commissariat du XIIème arrondissement. Devant les forces de l’ordre, la nouvelle tombe, Christophe est décédé dans la nuit du 28 au 29 mai lors d’une soirée de chem sex. « Selon les éléments de l’enquête que l’on a eu ce soir-là, il a pris de l’alcool, et l’homme avec qui il devait avoir des relations sexuelles lui a donné du GBL (gamma-butyrolactone, un solvant qui une fois ingéré se transforme en GHB, ndlr). Le mélange des produits l’a conduit à être victime d’un coma puis d’une overdose« , nous raconte péniblement Jean-Luc Romero Michel qui n’était pas au courant que son partenaire consommait de la drogue, notamment lors de relations sexuelles. « Je connaissais le chem sex avant le décès de mon mari, mais je sous-estimais l’ampleur du phénomène. »
L’émergence du chem sex en France
Contraction des termes anglais chemical et sex, « le chem sex se définit par l’usage de produits psychoactifs en contexte ou à visée sexuelle », informe Fred Bladou du comité scientifique de SOS Addiction. « C’est une pratique vieille comme le monde. Déjà dans les années 1970, on voyait certains groupes d’individus consommer du poppers ou de l’alcool pour avoir des relations sexuelles. » Et pour cause : « On a tous nos névroses. Avant de draguer, pour faciliter une relation sexuelle, on cherche quelque chose qui va nous désinhiber, nous mettre à l’aise. C’est là qu’interviennent les psychotropes. Ils altèrent et modifient notre comportement de manière à répondre à des injonctions de performance. »
Si allier psychotrope et sexe n’est pas nouveau, le phénomène de chem sex lui, est arrivé en France il y a une dizaine d’années. « Cette tendance est accompagnée par l’émergence de nouvelles modalités de rencontres (sites Internet et applications mobiles géolocalisées), de nouvelles drogues (les nouveaux produits de synthèse – NPS) et modalités de consommation – dont l’injection intraveineuse de stimulants dans le cadre de relations sexuelles, une pratique particulièrement à risque dénommée slam », note un rapport de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), publiée en 2017.
Comme l’indique l’organisme, « le chemsex s’est formalisé dans des outils de rencontres et des modes de réunions encadrés par des règles explicites en matière de pratiques sexuelles et d’usages de produits qui excluent les personnes ne souhaitant pas s’y adonner. De plus, en marge des réseaux de rencontres traditionnels, des sites exclusivement consacrés aux pratiques sexuelles avec produits se sont aussi développés. » « Ce qui fait la différence avec le chem sex, c’est que l’on rentre dans des pratiques ritualisées. Et contrairement à ce que la presse a pu relayer, il ne s’agit pas toujours de marathons sexuels pendant 3 jours avec 20 personnes », observe Fred Badou, également membre de l’association Aides.
Selon le dernier Net Gay Baromètre, une enquête menée tous les 3 ans en France et au Canada auprès d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) montre qu’en 2013, sur les 17 554 hommes interrogés, près de sept répondants sur dix déclarent avoir consommé au moins une fois une substance psychoactive (alcool ou drogue illicite) au cours des 12 derniers mois. Et 12,6 % d’entre eux avouaient avoir consommé au moins une fois une des substances associées au chemsex (cocaïne, MDMA/ecstasy, GHB, kétamine, cathinones). Concernant la pratique du slam, seuls 1,2 % des sondés déclarent l’avoir pratiqué au moins une fois.
Des chiffres qui ne concernent qu’une partie des usagers. « La communauté gay est la population décrite comme la plus touchée parce que c’est elle qui a connu en premier le chem sex. Le phénomène est arrivé il y a cinq ans. Aujourd’hui, les gay sont toujours majoritairement touchés, mais on voit de plus en plus de personnes hétérosexuelles le pratiquer, que ce soit des couples ou des gens qui font beaucoup la fête. » Ce que confirme Jean-Luc Romero Michel, qui milite désormais pour une meilleure prévention des dangers du chem sex. « Ce n’est pas un phénomène marginal. Il est en train d’exploser. » Pour l’homme politique, la crise sanitaire du Covid-19 n’a en rien freiné ces pratiques, bien au contraire. Confinés chez eux, de nombreux Français ont cherché de nouvelles sensations. « On va avoir de très mauvaises nouvelles », déplore-t-il. « Le manque de lieux de convivialité, la solitude ont poussé certains à chercher des paradis artificiels à travers la drogue. »
Le chem sex, un « sida numéro deux » ?
Outre-Atlantique, l’ampleur du phénomène est telle que le prestigieux New York Times a comparé le chem sex à l’épidémie de Sida qui a fortement touché la communauté homosexuelle dans les années 1980. « Cet article nous a fait bondir, s’énerve Fred Badou. Ce n’est pas comparable. On ne se contamine pas au chem sex, on ne peut donc pas comparer cette pratique à la maladie du Sida. Le nombre de morts n’est pas équivalent. Le chem sex ne tue pas autant que le Sida. On parle d’entre 20 et 30 décès par an pour le premier, contre des dizaines et des dizaines de milliers de victimes pour le second. » ll ajoute : « La comparaison ne sert à rien en termes de santé publique, c’est un discours effrayant qui ne donne pas de moyens de prévention. »
Un phénomène accentué par l’arrivée de nouvelles drogues
Selon l’OFDT, les drogues les plus employées pour le chem sex sont les poppers, le GHB/GBL, la cocaïne, les médicaments de performance sexuelle comme le Viagra, et plus rarement, la kétamine et la méthamphétamine. Mais la pratique a surtout explosé avec l’arrivée sur le marché des drogues de synthèse dès 2010. 3MMC, 4MEC, Méphédrone (Meph) et autres cathinones sont vendus sous forme de cristaux ou de poudre et imitent les effets de la cocaïne, de la MDMA et des amphétamines. Elles peuvent être ingérées sous forme de parachute (dans une boulette de papier à cigarette), diluées dans une boisson, sniffées, insérées dans l’anus à l’aide d’une seringue sans aiguille ou injectées en intraveineuse (le slam).
Comme l’informe Drogues Info Service, « les cathinones sont généralement utilisées pour leurs effets stimulants, entactogènes (elles favorisent le contact) et empathogènes (elles augmentent l’empathie). Elles procurent un sentiment d’euphorie, augmentent la faculté de concentration et la capacité de travail, la confiance en soi, procurent un sentiment de puissance, entraînent une intensification des sensations. En contexte sexuel, elles augmentent la sensualité et l’endurance. »
Problème : ces drogues sont non seulement parmi les moins chères du marché, mais surtout très faciles d’accès. L’ère du dealer qui vend ses produits sous le manteau est révolue avec les cathinones. « Tout le système de distribution et d’approvisionnement est bouleversé depuis une dizaine d’années. On voit une explosion des drogues 2.0 et du deal 2.0. Ces produits se vendent sur des sites en ligne, on les achète en deux secondes et ils arrivent dans notre boite à lettre », explique Fred Bladou. Ce qui inquiète beaucoup les associations. « Ça pose un problème de qualité des produits. Je préférerais que ce type de drogues soit vendu par un dealer qui connait ce qu’il y a dedans que sur internet », lâche-t-il. Sentiment partagé par Jean-Luc Romero Michel. « Il y a un mésusage. Ce sont des drogues produites en Chine, en Inde ou au Pays-Bas. Dès que les états les interdisent, ils créent des dérivés en trouvant un moyen de changer la formule chimique, qui deviennent légaux. On n’a même pas besoin d’aller sur le dark web pour trouver ses substances. On ne sait pas de quoi elles se composent, ni leur dosage. Parfois ils sont sous-dosés ou sur-dosés. Des fois c’est de la mort au rat ! », s’inquiète-t-il. Consommé également en contexte sexuel, le GBL contrairement au GHB n’est pas sur la liste des stupéfiants. Vendu sur Internet, il n’est soumis à aucun contrôle.
L’autre grand danger du chem sex est la polyconsommation, observe Hervé Martini, médecin addictologue et secrétaire général de l’Association Addictions France. Plusieurs produits sont associés. « Les consommateurs vont prendre des produits pour booster les performances sexuelles ou les sensations, puis d’autres pour atténuer la descente des drogues prises dans un premier temps. » C’est le début d’un cercle vicieux.
De (très) nombreux risques pour le consommateur
Des complications liées aux drogues ingérées
Sans surprise, le chem sex présente un danger pour la santé. Et ce pour de nombreuses raisons. La première : la consommation de drogues en elle-même. « Chaque produit génère des complications, comme la cocaïne qui augmente le risque de faire un infarctus« , donne en exemple l’addictologue. Concernant les risques des cathinones, la liste est longue. Ils sont surtout d’ordre neurologique ( insomnie, état confusionnel, contractions musculaires), psychiatrique (psychose sévère, hallucinations, agressivité…) et cardiaque (troubles du rythme cardiaque, infarctus du myocarde pouvant mener au décès). Ces drogues entraînent également l’augmentation de la température corporelle et donc une déshydratation. Lié à une activité intense comme peut l’être une relation sexuelle, « le coup de chaleur peut entraîner une perte de connaissance, un coma ou un accident cardiaque qui peuvent être mortels », informe Drogues Info Service. Comme beaucoup de drogues dures, les cathinones entraînent un risque de surdose et de dépendance notamment lié au « craving », l’envie irrépressible de consommer à nouveau et de prendre des doses plus importantes et répétées.
Le mode de consommation de ces produits présente lui aussi des dangers pour la santé. Le slam, d’autant plus si celui-ci n’est pas maîtrisé, entraîne des complications : abcès, septicémies, endommagement du réseau veineux, problèmes cutanés. Sans parler de « la polyconsommation qui double les risques », complète le Dr Martini. À court terme, consommer plusieurs produits peut causer des nausées, des vomissements, des troubles du rythme cardiaque, des vertiges et des pertes de connaissance notamment en cas de surdosage de GBL ou de kétamine. À long terme, la dépendance à un ou plusieurs produits s’installe. Dans les cas extrêmes, les usagers risquent une intoxication aigüe pouvant conduire à leur décès.
IST, abus sexuels… Une mise en danger de soi et d’autrui
Il y a également des risques propres à la pratique. « Le chem sex expose également à des risques infectieux. Sous drogues et perdant le contrôle, l’usager n’est plus en mesure de se protéger et oublie de mettre un préservatif. Il peut alors contracter le VIH, l’hépatite, la syphilis ou d’autres infections sexuellement transmissibles« , alarme le médecin. Dans ce contexte, la pratique du slam pose elle aussi problème : « partager ou réutiliser le matériel de consommation constitue des comportements à fort risque de contamination ou de réinfection (VIH, VHC, VHB, autres IST) », indique l’OFDT.
« Les consommateurs peuvent aussi être victime d’un black out, ne plus se souvenir de ce qu’il s’est passé. Il y a des risques d’ abus sexuels« , informe l’addictologue.
Un impact sur la sexualité et la vie sociale
Même en dehors des soirées chems, la vie change. Rien n’est plus comme avant, notamment dans sa vie sexuelle. « Il faut parler de l’impact sur la sexualité. Les relations affectives, le plaisir, les orgasmes ne passent plus que par le produit. Certains en viennent à penser qu’il n’est plus possible d’avoir des rapports sans produit. Ou à l’inverse, la sexualité est un prétexte à la consommation de stupéfiants », regrette-t-il. Les relations sociales peuvent se dégrader. Le chem sex et le slam peuvent être des facteurs de désocialisation, selon l’OFDT. « Les produits consommés ne sont pas anodins. Ils sont très addictogènes. C’est très facile de tomber dans la dépendance et de ne plus arriver à gérer sa consommation, note Fred Bladou. Quand on ne dort plus, que l’on ne mange plus, que l’on a eu trois jours de rapports sexuels intenses sous stimulants, il y a des effets psychologiques. Ils peuvent mener à la dépression. »
« C’est très difficile et long de s’en sortir quand on a une consommation sévère mais il existe pleins de solutions, assure Fred Bladou. Se sortir du chem sex et des drogues tout seul, ça peut être très dangereux et très dur. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler des professionnels de l’addiction. La première solution est donc de se faire aider par des groupes ou des associations comme Aides ou Narcotique anonyme, mais aussi par des médecins addictologues, des psychologues, des sexologues. La rencontre avec des soignants bienveillants, à l’écoute et sans jugements aide beaucoup. » Avis partagé par le Dr Martini, « Parler, c’est la première étape dans les addictions. Il ne faut pas que ce soit un tabou, il faut pouvoir en parler. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Si ce n’est pas le médecin traitant, ça peut être un autre soignant. Notre rôle c’est de mettre à l’aise le patient. » Sans jugement et dans la bienveillance, le médecin n’est pas là pour sermonner le patient ou lui demander d’arrêter du jour au lendemain. « Une fois qu’il nous confie ses addictions, on le prend en charge. On quantifie le problème, on se renseigne sur les produits consommés. Avec ces informations, on l’aide à travailler sur la réduction des risques et des dommages. » Progressivement, le médecin amène le patient à « limiter la durée des soirées de chem sex, à éviter d’être emballé ou embarqué là-dedans ». « On l’aide également dans les aspects relationnel et sexuel » qui peuvent être dégradés par le chem sex.
Des pouvoirs publics silencieux
Mais au-delà du travail des associations et des soignants, c’est une action du gouvernement et des autorités de santé qu’attendent Fred Bladou et Jean-Luc Romero Michel. « Aujourd’hui, la seule chose qu’ils font, c’est dire que la drogue c’est dangereux. On pisse dans un violon, ça ne sert à rien, au contraire, on fait presque naître une volonté de transgression chez certains individus », exprime le militant d’Aides. « Il y a une absence de paroles politiques. Je n’ai jamais entendu un seul ministre de la Santé parler de chem sex, s’étonne l’élu parisien. La pénalisation des drogues, ça ne fonctionne pas. La personne qui était avec Christophe lorsqu’il est tombé dans le coma a eu peur d’appeler la police, parce qu’ils avaient consommé des drogues illégales. Une seconde personne est venue, puis une troisième. C’est cette troisième personne qui a fini par appeler les secours. Mais c’était trop tard. »
Pour le politique, la prévention est plus que nécessaire. « Il faut informer les gens, les renseigner sur les mésusages notamment lors de l’achat de drogues, savoir ce qu’il y a dedans », estime l’adjoint à la mairie de Paris qui prône pour une dépénalisation des drogues avec « une vraie politique d’explication des dangers ». Pour ce second axe, la mairie de Paris travaille déjà dessus. « Nous investissons dans la prévention. Les associations font déjà un travail formidable, mais là, il faut que toutes les collectivités locales s’y mettent. Le chem sex ne se réduit pas à Paris ou Marseille, ça touche aussi les petites villes. »