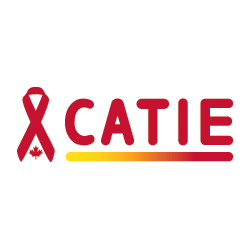Source : Catie
L’effet du traitement du VIH (TAR) est tellement transformateur que les chercheurs prévoient de plus en plus que les utilisateurs du TAR seront nombreux à connaître une espérance de vie quasi normale. Nombre de facteurs peuvent toutefois miner la capacité d’une personne à prendre son TAR exactement comme il est prescrit, à respecter continuellement ses rendez-vous en clinique et au laboratoire et à adopter de saines habitudes de vie. La santé mentale figure parmi ces facteurs nombreux. La santé mentale d’une personne peut être influencée par des facteurs biologiques, sociaux et structuraux, ainsi que par des événements passés ou actuels qui sont source de détresse psychologique et de traumatismes.
- La violence interpersonnelle peut être de nature physique, psychologique ou sexuelle
- Selon des chercheurs de Calgary, sur 1 064 personnes séropositives, 36 % avaient des antécédents de violence interpersonnelle
- Les victimes de violence avaient une santé plus fragile et moins de chances de survie à long terme, notamment si la violence avait eu lieu dans l’enfance
Accent sur la violence interpersonnelle
Selon une équipe de la Southern Alberta HIV Clinic à Calgary, la violence interpersonnelle « comprend la violence entre les partenaires intimes, les membres d’une même famille, les amis et les connaissances ». L’équipe a évalué plus de 1 000 personnes séropositives afin de connaître leurs antécédents de violence interpersonnelle. Les personnes qui disaient avoir été victimes de violence se faisaient diriger vers des travailleurs sociaux pour recevoir du counseling. Les chercheurs ont suivi les participants pendant neuf ans après l’évaluation initiale.
Trente-six pour cent des participants ont dévoilé avoir vécu de la violence interpersonnelle. Selon les chercheurs, malgré le counseling, ces personnes couraient plus de risques de présenter de nombreux indices d’une mauvaise santé, notamment un faible compte de cellules CD4+, une charge virale détectable persistante et une durée de survie réduite, comparativement aux personnes n’ayant pas signalé d’antécédents de violence.
Dans un rapport à paraître dans la revue AIDS, les chercheurs décrivent l’algorithme qu’ils proposent pour venir en aide aux victimes de violence interpersonnelle. Ils encouragent d’autres cliniques VIH à effectuer des évaluations semblables et à diriger les patients vers des travailleurs sociaux, que ce soit sur place ou ailleurs, afin de recevoir un traitement et un soutien psychosocial.
Détails de l’étude
En juin 2009, les chercheurs ont commencé à évaluer les participants pour déterminer s’ils avaient vécu de la violence interpersonnelle. Le suivi des participants a duré neuf ans après cette évaluation initiale.
Résultats
Plus du tiers des participants (36 %) ont dévoilé des expériences de violence interpersonnelle dans les proportions suivantes :
- violence interpersonnelle dans l’enfance seulement : 21 %
- violence interpersonnelle après l’atteinte de l’âge adulte seulement : 15 %
Sexe
Les femmes (46 %) étaient plus susceptibles que les hommes (33 %) de dévoiler des antécédents de violence interpersonnelle. Elles étaient également plus susceptibles (25 %) que les hommes (12 %) de signaler des actes de violence subis depuis qu’elles étaient des adultes.
Groupes ethnoraciaux
Les personnes autochtones étaient plus susceptibles (71 %) de dévoiler des antécédents de violence interpersonnelle que les personnes de race blanche (38 %) et les personnes d’origine africaine, caraïbéenne ou noire (20 %).
Affections médicales concomitantes
Aucune différence n’a été constatée entre les victimes de violence interpersonnelle et les non-victimes en ce qui concerne les taux d’affections médicales concomitantes, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les troubles gastro-intestinaux et les lésions nerveuses.
Les chercheurs ont toutefois constaté que les personnes ayant subi des actes de violence étaient considérablement plus susceptibles d’éprouver les problèmes suivants :
- consommation problématique de substances (dont la méthamphétamine, la cocaïne ou le crack et/ou l’héroïne et d’autres opioïdes)
- co-infection au virus de l’hépatite C
- pensées ou actes d’automutilation
- troubles de santé mentale
Abandon des soins
Au cours de l’étude, les chercheurs ont trouvé que les personnes ayant dévoilé des antécédents de violence interpersonnelle dans l’enfance étaient significativement plus susceptibles (40 %) d’abandonner les soins que les personnes ayant vécu de la violence interpersonnelle depuis l’âge adulte seulement (26 %) ou celles n’ayant signalé aucun antécédent de violence interpersonnelle (27 %).
Notons que les taux de discontinuation des soins attribuables à un déménagement hors du sud de l’Alberta étaient semblables sans égard aux antécédents de violence interpersonnelle.
Impact sur la survie
Selon les chercheurs, le risque de décès prématuré était presque le double (16 %) chez les personnes ayant dévoilé des antécédents de violence interpersonnelle dans l’enfance, comparativement aux personnes n’ayant aucun antécédent de violence interpersonnelle ou des antécédents de violence interpersonnelle survenus depuis l’âge adulte seulement (environ 8 %). Les chercheurs ont affirmé que les décès parmi les victimes de violence interpersonnelle dans l’enfance étaient « souvent associés à des problèmes de santé mentale et de dépendance (surdose de drogue, violence, suicide) ou à des complications du VIH/sida ».
Mesures du comportement et de la santé
Au cours de l’étude, les chercheurs ont constaté les conséquences défavorables suivantes chez les personnes ayant dévoilé des antécédents de violence interpersonnelle de n’importe quel genre, par rapport aux personnes n’ayant pas dévoilé de violence interpersonnelle :
- 36 % plus susceptibles de mettre fin aux soins
- 81 % plus susceptibles d’avoir une charge virale élevée, soit 500 copies/ml ou plus
- 47 % plus susceptibles de connaître une baisse du compte de CD4+ sous le seuil des 200 cellules/mm3
- 65 % plus susceptibles de mourir
Ces tendances se maintenaient sans égard au sexe, au groupe ethnoracial ou au niveau de scolarité des participants.
À retenir
L’équipe de recherche a fait valoir ceci : « Pour les victimes de maltraitance, les rendez-vous cliniques manqués, la discontinuation des soins de santé [et la mauvaise observance thérapeutique] reflètent souvent des antécédents de traumatismes et de stigmatisation ».
Quelles mesures sont en cours?
Selon les chercheurs, « il est crucial d’entamer un dialogue avec [les personnes séropositives] sur leurs antécédents de violence interpersonnelle. Lors d’une étude précédente menée également dans la Southern Alberta HIV Clinic, les participants étaient ouverts à l’idée de passer une évaluation de leurs antécédents de violence interpersonnelle parce qu’une relation de confiance existait déjà entre eux et leurs professionnels de la santé. L’évaluation des individus offrait l’occasion de diriger ceux-ci vers un travailleur social se spécialisant dans la violence familiale/interpersonnelle et les abus. La Southern Alberta HIV Clinic vise à évaluer chaque personne pour déterminer ses antécédents de violence interpersonnelle et à fournir l’occasion de parler aux travailleurs sociaux [de la clinique] à toutes les personnes qui en dévoilent. Les travailleurs sociaux permettent aux individus de parler de leurs traumatismes et peuvent élaborer des plans sécuritaires pour aider les patients à obtenir du soutien additionnel ».
Un héritage de violence
Cette étude albertaine met en évidence l’impact durable que la violence dans l’enfance exerce sur la santé des adultes. Le mécanisme précis par lequel la violence interpersonnelle dans l’enfance fragilise la santé plus tard n’est pas clair, mais il est probable que l’interaction de divers effets psychologiques et biologiques joue un rôle. Les chercheurs de Calgary ont mentionné d’autres études où l’on avait observé que des changements anormaux dans les hormones et les signaux chimiques participant à la réponse au stress étaient associés à un risque accru de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de dépression.
Cette étude est importante et s’ajoute à la masse croissante de données probantes révélant les séquelles importantes de la violence interpersonnelle, surtout si celle-ci a lieu dans l’enfance. Le travail effectué par cette équipe souligne l’importance d’aider les populations vulnérables à améliorer leur santé globale de façon durable.