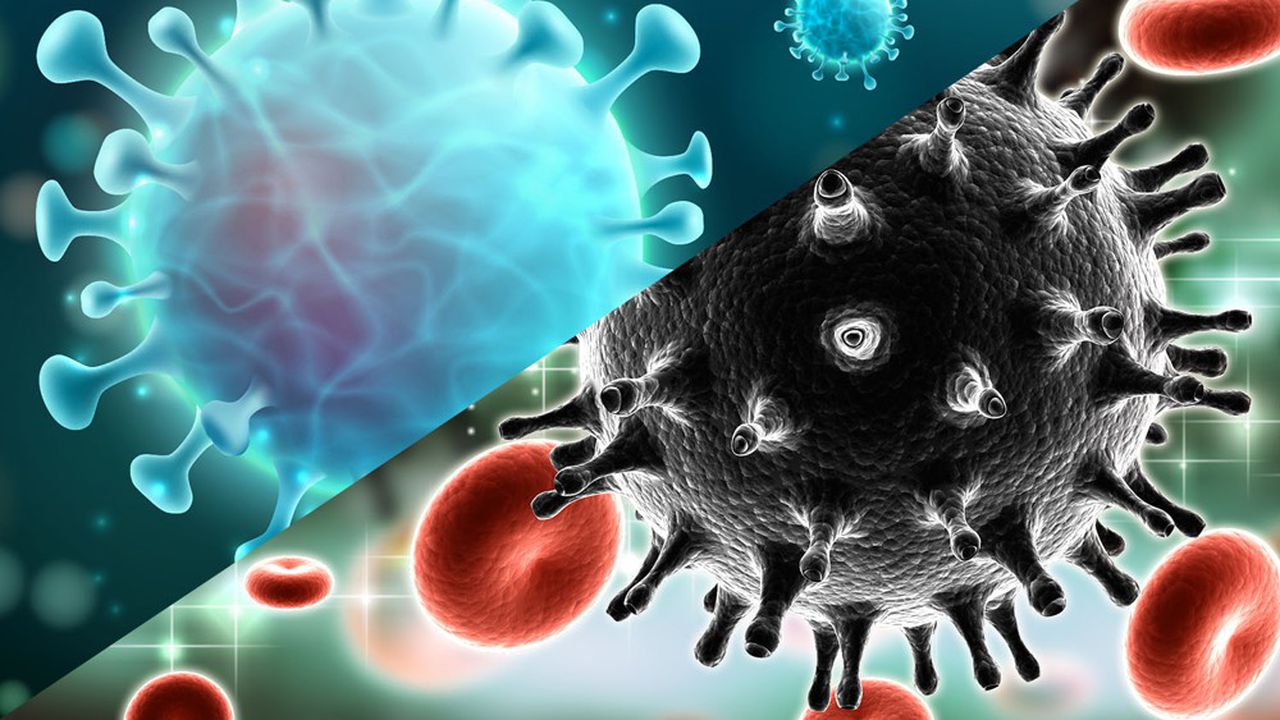- Rares sont les études traitant de personnes séropositives vaccinées contre la COVID-19
- Des scientifiques d’Israël ont étudié 143 personnes séropositives qui avaient reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech
- L’équipe a constaté la présence de taux élevés d’anticorps contre le SRAS-CoV-2 après la deuxième vaccination
Même si plusieurs essais cliniques pivots des vaccins anti-COVID-19 de première génération ont été menés, les fabricants n’ont pas publié de rapports détaillés sur l’efficacité des vaccins chez des populations particulières, notamment les personnes vivant avec le VIH. Pour combler cette lacune, des études par observation sont en cours.
Une équipe de recherche d’Israël a rendu compte des résultats obtenus auprès de 143 personnes séropositives qui avaient reçu les deux doses du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Selon l’équipe, les deux doses du vaccin ont réussi à déclencher la production d’anticorps pouvant s’attaquer au SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Les effets secondaires ont généralement été légers, et la charge virale en VIH n’a augmenté que très modestement chez 2 % des personnes vaccinées.
Détails de l’étude
Le personnel du Centre médical Sheba de Tel-Hashomer, à Tel-Aviv, prodigue des soins et des traitements à de nombreuses personnes séropositives vivant en Israël. Aussitôt que le vaccin de Pfizer-BioNTech a été approuvé dans ce pays, le personnel soignant du centre a commencé à l’offrir aux adultes séropositifs qui avaient déjà pris rendez-vous dans la clinique pour recevoir des soins de routine. En tout, 143 personnes séropositives ont accepté de se faire vacciner.
Le groupe avait le profil moyen suivant au début de l’étude :
- âge : 50 ans (33 % des personnes avaient 55 ans ou plus)
- 92 % d’hommes, 8 % de femmes
- principaux groupes ethnoraciaux : 95 % de Blancs, 4 % d’Africains
- indice de masse corporelle : 25
- compte de cellules CD4+ : 700 cellules/mm3
- toutes les personnes suivaient un traitement contre le VIH, et 95 % d’entre elles avaient une charge virale indétectable (moins de 40 copies/ml)
- 14 % des personnes avaient d’autres problèmes de santé, tels que l’hypertension, le cancer, la co-infection au virus de l’hépatite C, l’insuffisance rénale chronique, l’obésité et l’AVC
À des fins de comparaison, l’équipe de recherche a évalué des échantillons de sang prélevés auprès de 400 travailleurs et travailleuses de la santé séronégatifs en bonne santé.
Aucune des personnes inscrites n’avait été infectée par le SRAS-CoV-2 auparavant.
Rappelons que le vaccin de Pfizer-BioNTech est administré en deux doses distinctes, habituellement à plusieurs semaines d’intervalle.
Résultats
Quatorze jours après la première vaccination, des anticorps contre le SRAS-CoV-2 étaient présents dans les proportions suivantes :
- personnes séropositives : 51 %
- personnes séronégatives : 59 %
En général, les taux d’anticorps étaient plus faibles chez les personnes séropositives que chez les personnes séronégatives après la première dose du vaccin. Notons que l’équipe de recherche n’a évalué les taux d’anticorps que peu de temps après chaque vaccination. Il est possible que des quantités plus élevées d’anticorps aient été produites après plus de temps entre la première et la deuxième injection.
Entre 18 et 26 jours après la deuxième dose du vaccin, des anticorps pouvant s’attaquer au SRAS-CoV-2 étaient présents dans les proportions suivantes :
- personnes séropositives : 98 %
- personnes séronégatives : 99 %
Notons aussi que les taux d’anticorps dans les échantillons de sang des deux groupes étaient en moyenne cinq fois plus élevés après la deuxième inoculation, par rapport à la première.
Accent sur le VIH
En analysant les anticorps produits à la suite de la deuxième vaccination, l’équipe a constaté que toutes les personnes séropositives sauf quatre avaient des anticorps qui combattaient le SRAS-CoV-2. Ce qui suit est une brève description des quatre personnes chez qui on n’a pas détecté d’anticorps après la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech :
- un homme greffé du rein de 66 ans qui recevait trois sortes de médicaments pour empêcher son système immunitaire de rejeter l’organe transplanté
- un homme de 58 ans sous dialyse
- un homme de 72 ans souffrant de coronaropathie
- une femme de 64 ans atteinte d’arthrite qui prenait le médicament colchicine et qui, selon l’équipe de recherche, « est tombée gravement malade de la COVID-19 quatre semaines après la deuxième dose du vaccin »
Impact des faibles comptes de cellules immunitaires sur la production d’anticorps
Avant la vaccination, le nombre de personnes ayant un compte de CD4+ relativement faible était le suivant :
- moins de 350 cellules/mm3 : 12 personnes
- moins de 200 cellules/mm3 : 3 personnes
Selon l’équipe de recherche, l’organisme de toutes ces personnes a réussi à produire de grandes quantités d’anticorps contre le SRAS-CoV-2 après leur deuxième vaccination.
Innocuité
En ce qui concerne les effets secondaires, de nombreuses personnes séropositives ont éprouvé de la douleur au site de l’injection, mais elle était généralement légère et s’estompait après un jour.
La fatigue et un mal de tête figuraient parmi les effets secondaires courants après la première dose du vaccin. Après la deuxième, la fatigue et la fièvre étaient courantes. Dans la plupart des cas, la fièvre était légère.
Trois personnes se sont plaintes de picotements nerveux dans les régions suivantes du corps :
- visage : 1 personne
- bras vacciné : 1 personne
- les deux bras : 1 personne
Cet effet secondaire s’est résorbé dans les 48 heures.
Les médecins ont détecté une augmentation des taux d’enzymes hépatiques dans les échantillons de sang de deux personnes, mais ce problème s’est résolu après quelques jours.
Mesures liées au VIH
Compte de cellules CD4+
Le compte de cellules CD4+ a diminué très modestement après la vaccination, passant de 700 cellules/mm3 à 634 cellules/mm3, mais aucun déclin de la santé générale n’a été associé à cette baisse. Aucun changement significatif ne s’est produit dans le rapport des cellules CD4 aux cellules CD8, ce qui atteste la stabilité de la santé générale du système immunitaire. La baisse du compte de cellules CD4+ ne devrait surprendre personne, car, lors d’une étude menée auprès de 40 000 personnes séronégatives ayant reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, une réduction temporaire des taux de lymphocytes avait été observée après la vaccination. On peut en savoir plus en cliquant ici : Le vaccin de Pfizer-BioNTech.
Charge virale
Chez trois personnes dont la charge virale avait été indétectable précédemment, celle-ci a augmenté jusqu’à 47, à 52 et à 92 copies/ml après la deuxième vaccination. Ces changements sont considérés comme très modestes.
Chez les trois personnes dont la charge virale a augmenté, le compte de cellules CD4+ avait baissé sous le seuil des 200 cellules dans le passé (avant qu’elles commencent le TAR). Un faible compte de CD4+ antérieur laisse soupçonner la présence de déficiences immunologiques persistantes, mais aucune preuve à ce sujet n’a été présentée par l’équipe de recherche.
Notons que le suivi n’a duré que quelques semaines après la deuxième vaccination.
À retenir
Même si la présente étude n’a porté que sur 143 personnes séropositives, ses résultats sont très prometteurs. La même équipe de recherche israélienne a lancé une étude de plus grande envergure auprès d’au moins 500 personnes séropositives qu’elle compte suivre pendant au moins deux ans (Itsik Levy, M.D., Centre médical Sheba, communiqué personnel). Espérons que des études semblables seront menées auprès de personnes ayant reçu des vaccins contre la COVID-19 dans différentes parties du monde.
À l’instar de nombreuses équipes de recherche qui étudient la réponse immunitaire aux vaccins anti-COVID-19, l’équipe israélienne s’est concentrée sur les anticorps qui s’attaquent au SRAS-CoV-2. Il existe cependant un autre genre de réponse immunitaire qui mériterait d’être surveillée, soit l’immunité cellulaire. Pour éclairer le rôle de celle-ci, il faudrait étudier des cellules immunitaires qui combattent les virus, telles les cellules T et les cellules tueuses naturelles. Ces cellules produisent des substances antivirales lorsqu’elles s’attaquent à des virus ou à des cellules infectées par des virus. L’évaluation de l’immunité cellulaire pourrait fournir des informations additionnelles sur la manière dont les vaccins protègent contre la COVID-19. Notons cependant que les évaluations de l’immunité cellulaire sont plus fastidieuses à faire et ne font pas partie des activités de tous les laboratoires.
Comme cette étude israélienne n’a pas encore été soumise à un examen par des pairs, il est important de considérer ses résultats comme préliminaires, quoique très prometteurs.