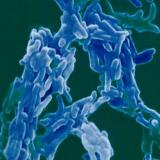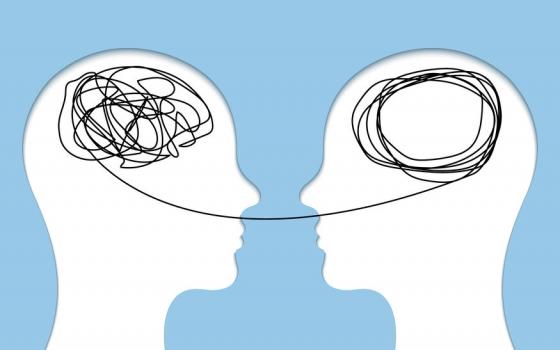Source: lequotidiendupharmacien.fr
Depuis plusieurs mois, les industriels, et tout particulièrement les fournisseurs de génériques, alertent les autorités françaises et européennes des risques que fait courir l’inflation sur la production de médicaments. La hausse des coûts (de l’énergie, des transports, des matières premières) pourrait conduire à la mise à l’arrêt de certains sites, tandis que d’autres craignent des pertes irrémédiables de produits consécutives à d’éventuels délestages, le tout à l’aune des ruptures de médicaments qui n’ont cessé de s’aggraver ces dix dernières années.
Les signalements des ruptures et risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) atteignent des sommets. Leur nombre est passé de 44 en 2008 à 2 160 en 2021 après des hausses spectaculaires en 2018 (871), 2019 (1 504) et 2020 (2 446). Et cela ne va pas en s’arrangeant, souligne l’Académie nationale de pharmacie, qui pointe les 3 278 signalements enregistrés pour les neuf premiers mois de l’année 2022. Les données collectées par le GERS Data vont dans le même sens : le nombre de références en rupture pendant au moins une semaine est passé de 6,5 % en janvier 2022 à 12,5 % en août dernier.
Au comptoir, les difficultés ne sont que plus nombreuses. Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) tire le signal d’alarme depuis plusieurs semaines. Alors qu’il évoquait une moyenne de 90 médicaments en rupture début octobre, il estime désormais qu’il y a en permanence « plus de 100 manquants » dans son officine. Et dans toutes les classes thérapeutiques. Pierre-Olivier Variot énumère ainsi « paracétamol pédiatrique, anticancéreux, antidiabétiques, antihypertenseurs… ». L’ANSM confirme : « Le nombre important de ruptures de stock de MITM n’est pas un phénomène limité au territoire national. Il s’exprime à l’identique à l’échelle européenne et internationale. Toutes les classes de médicaments sont concernées par les ruptures de stock ou tensions d’approvisionnement, mais trois classes parmi les MITM sont plus particulièrement exposées : les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux et les médicaments du système cardiovasculaire. »
Gérer les ruptures
Les prescripteurs le savent et tentent de s’adapter. Des confrères voient de plus en plus d’ordonnances mentionnant plusieurs propositions de médicaments, justement pour permettre au pharmacien de délivrer un traitement malgré les ruptures de stock qui peuvent ne pas être les mêmes d’une semaine à l’autre. Dans tous les cas, les pharmaciens ne s’économisent pas pour trouver des solutions : dépannage entre pharmacies, sollicitation de plusieurs grossistes, appel aux laboratoires concernés et, en dernier recours, appel au prescripteur. Selon la dernière enquête du Groupement pharmaceutique de l’Union européenne (GPUE) présentée début 2022, les équipes officinales passent en moyenne 5,1 heures par semaine à gérer les ruptures de stock.
Les causes multifactorielles de ces pénuries sont bien identifiées, rappelle l’ANSM : « Capacité de production insuffisante, difficultés survenues lors de la fabrication des matières premières ou des produits finis, défauts de qualité sur les médicaments, décisions prises par l’ANSM ou d’autres agences partenaires (FDA, etc.) de suspendre l’activité d’un établissement, fabricant ou exploitant, à la suite d’inspections qui remettent en cause la qualité des médicaments… » Mais les plans anti-rupture qui se succèdent depuis une dizaine d’années n’ont pas résorbé le problème. Pire, de nouvelles menaces pèsent sur l’approvisionnement : la guerre en Ukraine et la crise énergétique. En mai dernier, l’association française des fabricants de génériques, le GEMME, alertait sur « les grandes difficultés auxquelles ses membres ont à faire face : hausse des coûts des matières premières (principes actifs, intermédiaire chimique, packaging…) et de l’énergie ». Une situation « d’autant plus problématique que les tensions internationales en cours laissent présager une accélération ainsi qu’une installation durable de l’environnement inflationniste actuel ». Un avertissement qui ne se limite pas à la France
Une situation insoutenable
L’organisation Medicines for Europe, représentant les génériqueurs au niveau européen, s’est fendue d’une lettre ouverte le 27 septembre dernier à l’intention des ministres européens de l’énergie et de la santé, ainsi qu’aux commissaires européens de l’énergie, de la santé, du marché intérieur et de l’économie. Les génériques, « qui représentent 70 % des médicaments dispensés en Europe », font l’objet, depuis 10 ans, d’une stricte régulation du prix et de mesures d’austérité budgétaire mettant les fabricants dans une « situation insoutenable ». Ces derniers font désormais face, en raison de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, à une inflation générale de plus de 9 % et à une hausse des coûts sans précédent sur les matières premières (+50 à +160 %), les transports (jusqu’à +500 %) et les prix de l’énergie.
« Les prix du gaz et de l’électricité ont atteint des niveaux records en 2022 à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine et certains producteurs de médicaments risquent de subir des rationnements en gaz ou de ne pas être capables de poursuivre leur activité de fabrication », prévient Elisabeth Stampa, présidente de Medecines for Europe. En effet, des fabricants font état d’une facture d’électricité multipliée par dix ! À cela s’ajoute la menace de délestages énergétiques pour faire face à une éventuelle interruption des approvisionnements de gaz russe et, en France, à une baisse inédite de la production d’électricité nucléaire, ce qui pourrait conduire à des pertes irréversibles de lots de médicaments. Medicines for Europe appelle donc la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne à travailler main dans la main pour trouver des solutions et ainsi « garantir l’accès et la disponibilité des médicaments ».
Les médicaments matures pénalisés
(…)
La suite de l’article disponible ici : lequotidiendupharmacien.fr