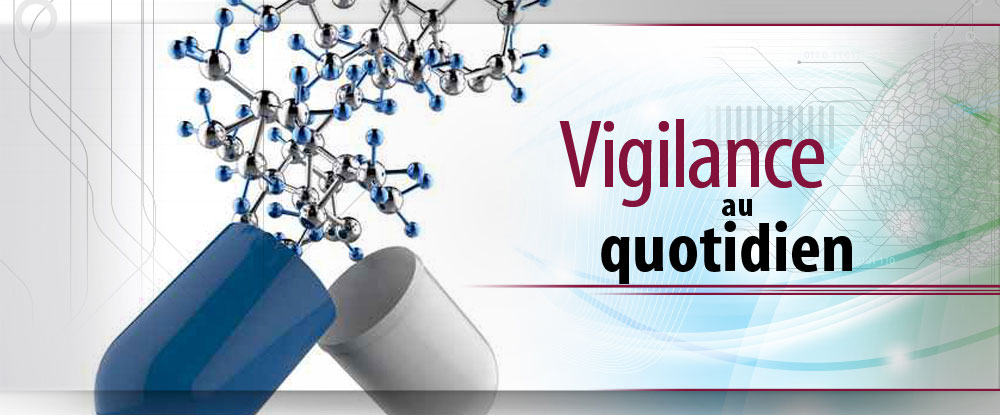Source : seronet.info
Le 15 mai dernier, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites au ministère de la Santé, le professeur François Dabis, directeur de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, a présenté le plan de recherche conduit par l’ANRS en matière d’hépatites virales. Que fait l’agence sur le VHC ? Qu’entreprend-t-elle dans le domaine du VHB ? A quels projets travaille-t-elle ?
En France, les hépatites B et C touchaient, en 2014, plus de 500 000 personnes et l’on estime que chaque année environ 4 000 personnes meurent des suites de ces infections virales chroniques d’après les données épidémiologiques de Santé Publique France. La question de santé publique reste donc entière.
Ces dernières années, c’est dans le domaine du VHC que les progrès ont été les plus importants puisqu’il y a aujourd’hui un accès universel au traitement anti-VHC. Cela s’est fait en quatre grandes étapes, a rappelé François Dabis. D’abord une décision politique : le 25 mai 2016, Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, approuve l’accès universel au traitement anti-VHC. En septembre de la même année, est publiée la deuxième édition du rapport d’experts-es sur la prise en charge du VHC, coordonnée par le professeur Daniel Dhumeaux. Autre tournant. En mars 2017, le prix des agents viraux directs (AVD ou AAD) est aligné pour toutes les combinaisons anti-VHC. Mars 2018 : ces mêmes médicaments deviennent disponibles dans les pharmacies de ville. La situation n’est pas la même en matière de VHB, puisqu’on sait soigner cette maladie en la contrôlant, mais on ne sait toujours pas la guérir. Reste qu’il existe une vaccination très efficace contre le VHB.
Que fait l’ANRS en matière de recherche sur les hépatites virales ?
Pour la période 2018-2020, l’ANRS s’est fixée cinq priorités de recherche dont trois sont directement ciblées sur les hépatites virales. Le premier est de contribuer à contrôler les trois épidémies dont elle a la charge (VIH, VHC, VHB). En travaillant sur la prévention biomédicale, ce qui est fait sur le VIH et qui est désormais prioritaire sur le VHB, en renforçant le dépistage et le suivi, ce qui est fait sur le VIH et qui est aussi prioritaire sur le VHC et le VHB. Troisième axe : l’observation et l’évaluation. Il s’agit de connaître précisément la taille des épidémies, leurs caractéristiques et leur évolution. Le deuxième est de mieux lutter contre le VHB, d’aller du traitement à la guérison, c’est tout le sens du programme HBV Cure. Autre axe : optimiser la vie avec le VIH. Cela passe par la simplification thérapeutique, l’amélioration de la qualité de vie, et bien sûr la prise en charge des comorbidités (VHB, VHC, etc.) Le troisième axe prioritaire concernant les hépatites, c’est la prise en charge des maladies du foie à l’ère de la guérison thérapeutique du VHC.
Sur ces trois grands points, l’agence suit ses grands principes directeurs : rapprocher la France et l’international ; miser sur la multidisciplinarité et la transversalité ; s’appuyer sur la mobilisation communautaire. Le financement direct de la recherche (le cœur de métier de l’agence) représente 92,5 % du budget. Cela représente 40,3 millions d’euros de crédits ouverts (soit une augmentation de 1,4 %). La recherche fondamentale et clinique sur les hépatites en France représente 21 % des crédits ouverts, la recherche en sciences humaines et sociales et en santé publique représente 10 % des crédits ouverts, une partie concerne les hépatites virales. Enfin, la recherche dans les pays partenaires (Sud, Est) représente 18 % des crédits ouverts ; la encore, une partie concerne les hépatites virales. Au total, ce sont 25 % du budget de l’agence qui sont consacrés aux hépatites virales. L’ANRS comprend différentes actions cordonnées (AC) qui sont en charge de l’animation scientifique. Cinq d’entre elles traitent des hépatites virales : l’action coordonnée (AC) 42 qui travaille sur les virus des hépatites ; l’AC 43 qui travaille sur la virologie médicale VIH et hépatites, l’AC 45 qui travaille sur la recherche clinique sur les hépatites (France et international), l’AC 46 qui travaille sur sciences humaines et sociales et santé publique et l’AC 47 en charge de l’épidémiologie VIH et hépatites virales.
Quelles priorités pour les actions coordonnées ?
On l’a vu, il y en a deux priorités : une sur les virus des hépatites, l’autre sur la recherche clinique au Nord comme au Sud sur les hépatites. Pour la première, les thèmes prioritaires concernent le métabolisme lipidique et le VHC, l’enjeu est, ici, de mieux comprendre la physiopathologie des maladies du foie qui sont induites par le VHC : le syndrome métabolique (ce n’est pas une maladie en tant que tel, mais un ensemble de signes physiologiques qui augmentent le risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux), la résistance à l’insuline, la stéatose, la fibrose. Il y a également l’interaction hôtes-virus. Il s’agit, dans ce domaine, d’étudier les mécanismes virologiques, immunologiques et cellulaires de la persistance virale ainsi que leurs détournements par les virus des hépatites. Autre thème priorité : la carcinogenèse viro-induite. Cela veut dire qu’on essaie de comprendre les mécanismes des virus (VHB et VHC) qui provoquent des cancers. Par exemple, le rôle cancérigène de certaines protéines virales, le stress oxydant accru des cellules, etc. Dernier grand thème : le HBV Cure, autrement dit la guérison de l’infection VHB. Là, il s’agit de caractériser de nouvelles cibles thérapeutiques, d’identifier des biomarqueurs de la guérison, d’évaluer de nouvelles approches thérapeutiques dans des modèles expérimentaux et des essais cliniques.
Pour la seconde, on y traite de sujets comme, foie, alcool et métabolisme ; complications après la guérison de l’infection par le VHC, greffe, sévérité des hépatites virales, hépatites B et D et autres hépatites virales. Et cela, en prenant en compte les spécificités régionales et la disponibilité des traitements, en travaillant sur l’adaptation des schémas de dépistage, de traitement et de suivi après guérison virologique du VHC et contrôle virologique du VHB, en travaillant sur les comorbidités pour le foie (usage d’alcool, co-infection avec le VIH, etc.), en réalisant des essais pour améliorer le traitement des hépatites B et D, en travaillant sur l’hépatite E, etc. Comme on le voit, il y a beaucoup à faire.
Prévenir et dépister : deux axes de travail
Prévenir et dépister sont des stratégies clés pour freiner la progression des épidémies liées aux virus des hépatites, a rappelé François Dabis, le 15 mai dernier. Le renforcement de ces actions est particulièrement important auprès des populations vulnérables à ces infections que sont les personnes usagères de drogues, les personnes incarcérées, les personnes migrantes, ou encore les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. On sait également que certaines régions de France sont plus touchées, comme la Guyane. Du coup, l’ANRS a lancé plusieurs études qui entendent apporter de nouvelles solutions en matière de dépistage et de prévention.
C’est le cas de l’’étude ANRS Midas (Migrants dépistage accès aux soins) qui a débuté en 2018. Son objectif est d’améliorer le dépistage du VIH, des hépatites virales ainsi que d’autres IST, du diabète, de l’hypertension artérielle et de la tuberculose et ainsi l’accès aux soins des personnes migrantes originaires d’Afrique sub-saharienne dans le territoire Sud du département des Hauts-de-Seine (Île-de-France).
Autre projet, l’étude ANRS Remind, démarrée également en 2018. Son objectif est de promouvoir le dépistage répété du VIH et d’autres IST chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en France.
L’étude ANRS MaHeVi, initiée en 2017, a pour objectif de documenter l’épidémiologie des hépatites B, C, D et du VIH dans la population générale adulte vivant sur le fleuve Maroni, frontière entre la Guyane française et le Surinam.
L’étude ANRS Prévenir, démarrée en 2017, a pour objectif d’inclure d’ici 2020 en Île-de-France 3 000 personnes volontaires, séronégatives, mais présentant un risque élevé d’infection par le VIH, pour évaluer l’impact d’actions de prévention ciblées sur les populations les plus exposées au risque d’infection, de programmes de dépistage répétés ainsi que d’actions permettant l’accès rapide au traitement et aux soins pour les personnes dépistées séropositives au VIH. Dans le cadre de ce programme de recherche interventionnelle, un dépistage des hépatites est systématiquement proposé.
On pourrait également citer ANRS-Pride, un essai d’intervention sur la mise à niveau des mesures de réduction des risques infectieux en prison en France, ou le projet Outsider, une intervention éducative d’accompagnement à l’injection hors les murs ou le projet d’emporwerment en santé sexuelle pour réduire les vulnérabilités sociales et de santé chez les personnes immigrées d’Afrique sub-saharienne en Île-de-France, projet conduit par Annabel Desgrées du Loû.
Hépatite C : que propose précisément l’ANRS ?
Rappelons qu’en France, le nombre de personnes présentant une infection chronique au VHC était estimé à 192 000 en 2011 dont 75 000 ne seraient pas encore dépistées (Source : Santé Publique France). On dispose aujourd’hui de traitements de l’infection par le VHC particulièrement efficaces : plus de 95 % des personnes infectées de manière chronique sont désormais guéries après quelques semaines (de huit à douze) de traitement par les AVD. Néanmoins, une faible proportion de personnes développe des résistances aux traitements. Par ailleurs, certaines personnes, plus gravement atteintes, développeront des tumeurs du foie malgré l’éradication du virus.
L’ANRS a mis en place des projets de recherches cliniques afin de mieux faire face à ces complications dans le futur. Il y a l’essai ANRS Revenge ; essai qui a démontré l’efficacité d’une combinaison sofosbuvir et grazoprevir/elbasvir associée à la ribavirine dans le traitement des personnes infectées par le VHC et en échec thérapeutique suite à la prise d’un premier traitement par agents antiviraux directs. Des résultats ont été publiés en 2017 dans la revue scientifique « Clinical Infectious Diseases ». Par ailleurs, l’ANRS est le promoteur et suit, en collaboration avec la société française d’hépatologie (Afef) 14 000 personnes infectées par le VHC dans le cadre de la cohorte ANRS Hepather, 9 000 d’entre elles ayant déjà bénéficié d’un traitement.
Hépatite B : que propose l’ANRS ?
En 2004, on estimait en France qu’environ 300 000 personnes étaient infectées de manière chronique par le VHB. Si aujourd’hui on ne dispose pas encore de moyen de guérir l’infection par l’hépatite B, un vaccin prophylactique efficace à 95 % existe depuis 1982 et des médicaments efficaces pour le traitement de l’infection chronique sont utilisables depuis quelques années.
L’ANRS est le promoteur et cofinance le suivi à long terme de la cohorte Hepather de plus de 6 000 personnes infectées par le VHB. Comme on a vu plus haut, une initiative de recherche ayant pour objectif la guérison de l’hépatite B (« HBV Cure ») est soutenue depuis 2013 par l’ANRS dans le cadre de ses actions coordonnées. Une conférence internationale, l’ANRS HBV cure workshop est organisée, chaque année, à Paris et a réuni en avril 2018 près de 300 chercheurs afin de faire le point sur les futures pistes de guérison.
Recherche sur les hépatites dans les pays du Sud
Au niveau mondial, on compte 328 millions de personnes infectées par les virus des hépatites B et C et ceux-ci sont actuellement responsables de près de 1,4 million de décès par an, rappelait François Dabis en mai dernier.
L’ANRS soutient des projets de recherche concernant l’infection par les hépatites B et C dans plusieurs pays du Sud. Il y a, par exemple, l’étude ANRS Tacéco, qui a récemment démontré le coût efficacité d’une stratégie thérapeutique à base de sofosbuvir chez des personnes atteintes d’hépatite C chronique dans le contexte de trois pays d’Afrique subsaharienne, ceci après avoir démontré en 2016 l’efficacité de ce type de stratégie dans l’essai ANRS Tax mené au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
L’étude ANRS/Nida Drive-in est actuellement menée auprès de personnes usagères de drogues injectables à Hai Phong au Vietnam où cette population est la plus touchée par le VIH/sida et l’hépatite C et où des approches innovantes sont nécessaires pour un contrôle durable de ces épidémies.
L’étude ANRS CohMSM (dont AIDES est co-investigateur) a confirmé la forte prévalence de l’infection par le VIH dans la population d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo. Les investigateurs ont récemment mis en avant qu’une forte proportion (plus de 90 %) des hommes non infectés, inclus dans l’étude, qui se voyaient proposer la vaccination contre le VHB, l’acceptait.
Comme on le voit, l’ANRS mène de nombreux projets et a , en matière de lutte contre les hépatites, de fortes ambitions. Ambitions dont on trouve également la traduction dans l’appel de Bordeaux en faveur de la lutte contre les hépatites virales B et C, lancé lors de la 9econférence internationale francophone VIH/hépatites Afravih en avril 2018, dont l’ANRS est un partenaire. Cet appel a déjà été signé par plus de 1 200 personnes.