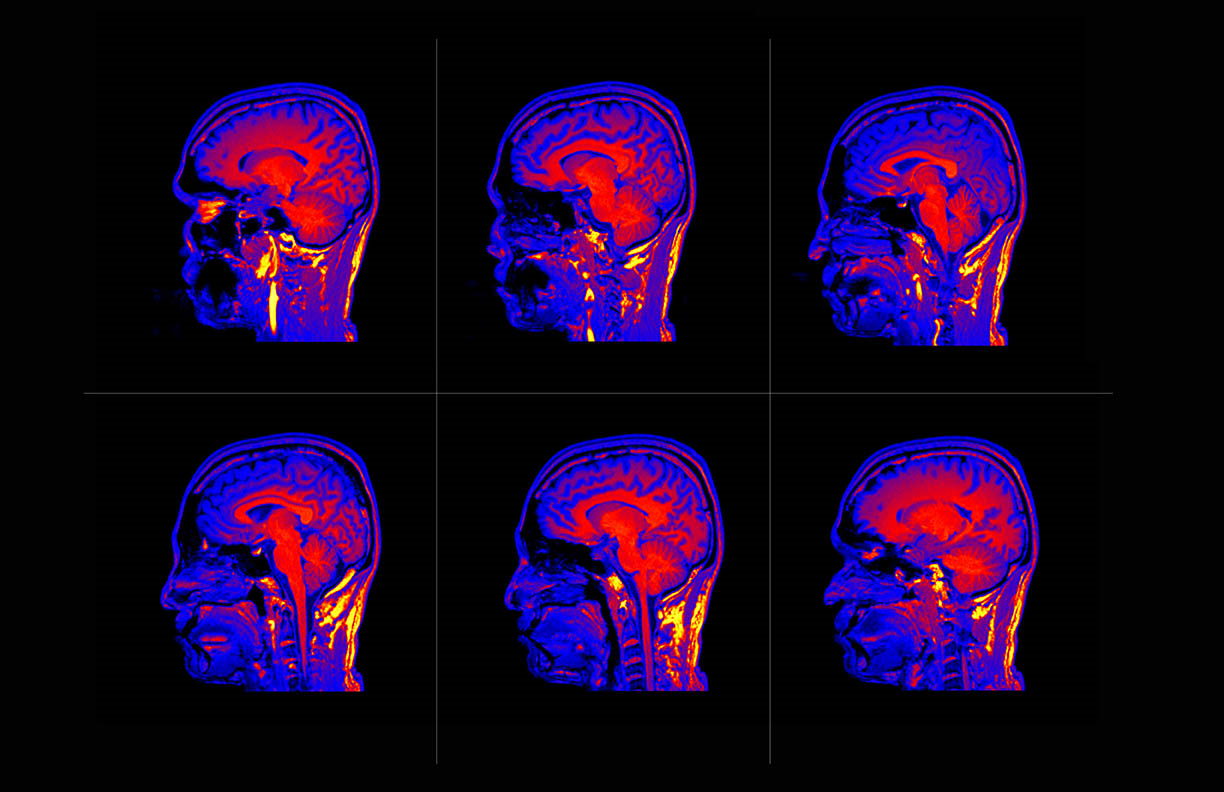Source : LCI
Devant la multiplication des publications qui comparent en ligne la Covid et VIH, nous avons décidé de remettre en avant cet article publié début décembre actualisé et agrémenté des propos du professeur et chercheur Jean-Daniel Lelièvre.
Moins d’une année. Le délai de mise au point des premiers candidats vaccins contre la Covid-19 a bouleversé tous les précédents de la médecine. Et amène à faire des comparaisons avec d’autres pathologies. En décembre, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, des internautes s’interrogeaient sur les réseaux sociaux : pourquoi ce virus n’a-t-il toujours pas son vaccin en 40 ans de recherches quand la Covid en a déjà près de dix en quelques mois de pandémie ?
Des messages récurrents, qui traduisent aussi une défiance vis-à-vis des vaccins contre la Covid. En effet, un développement aussi rapide est jugé suspect : si certains doutent qu’il puisse être efficace en étant mis au point dans un laps de temps si court, d’autres insinuent que le vaccin contre le VIH n’est pas aussi rapide car les enjeux économiques seraient moindre qu’avec le coronavirus. De quoi faire bondir les spécialistes tels qu’Étienne Decroly, virologue au CNRS. Il indique que comparer les deux virus est par nature trompeur.
Deux familles différentes de virus
Car si ces deux maladies sont des « virus », elles ont de nombreuses différences. À commencer par le fait qu’elles ne résultent pas d’une infection par des virus appartenant à la même famille. Ainsi, le VIH est un « rétrovirus« , nous explique le spécialiste en virus émergents et nouveaux pathogènes, c’est-à-dire que la réplication de son génome nécessite la retranscription de son ARN en ADN capable de s’intégrer dans le génome de la cellule hôte. Et sa « caractéristique principale » est qu’il s’attaque au système immunitaire. Bien que les coronavirus soient des virus ARN, ils ont une stratégie de réplication complètement différente et ne s’attaquent pas au système immunitaire.
La deuxième est le type d’infection que les deux maladies provoquent. L’une est persistante, l’autre est aiguë. En substance, cela signifie que pour le VIH, une fois le matériel génétique intégré dans les cellules, celles-ci persistent dans le corps. Au contraire, pour la Covid-19, le matériel génétique du virus n’est jamais rétro-transcrit et intégré. Ce qui facilite le contrôle de l’infection par l’organisme. En somme « le système immunitaire peut éliminer tout le virus. S’il y arrive, le virus ne circule plus dans l’organisme« , résume Étienne Decroly.
Un fonctionnement et une propagation radicalement différents provoquent forcément des réponses distinctes. Dans le cas du Sida, la clé réside dans la quête d’« un vaccin qui doit être stérilisant ». Il faut éviter toute infection et intégration de la maladie. Nécessaire contre le VIH, cette caractéristique n’est pas l’enjeu principal pour la Covid-19, pour lequel il faut essentiellement acquérir une immunité suffisante pour ne pas développer de formes sévères. En somme, pour prendre la conclusion d’Étienne Decroly : « Lorsqu’on combine rétrovirus, latence et système immunitaire affecté, le développement d’un vaccin devient forcément beaucoup, beaucoup plus complexe. »
Jean-Daniel Lelièvre, chercheur au sein de l’Institut Mondor de recherche biomédicale (Inserm/Université Paris Est Créteil), partage ces réflexions. Il met en avant un point central : le fait que l’on puisse guérir de la Covid-19 sans traitement. « Dès lors », explique-t-il, il suffit d’observer l’action des anticorps neutralisants, ceux qui agissent contre la fameuse protéine Spike. On savait quoi cibler. » Il lui semble en tout cas absurde de comparer ainsi une pathologie avec une autre. « Rien qu’au niveau des cancers, il en existe qui sont très bien pris en charge et d’autres qui résistent aujourd’hui à la médecine. Celui du pancréas par exemple, fait des ravages. »
Des efforts « considérables » contre le VIH
Seulement, si des publications Facebook insinuent qu’il y aurait moins d’efforts engagés dans la recherche contre le Sida, ce n’est absolument pas le cas. Étienne Decroly se remémore ainsi ce début des années 1980, lorsque le virus avait émergé et que « des dizaines d’industries se sont mises à réaliser des essais vaccinaux ». Sans qu’ils n’aboutissent. Des « efforts considérables » équivalents à ceux mis en place face à cette pandémie. Mais à une autre époque. Interrogé par la RTBF, Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne à l’hôpital Erasme, corrobore cette idée. Ce n’est pas une question d’argent. « Il y a énormément de moyens financiers qui ont été injectés dans cette recherche, mais à une époque aussi où la biologie moléculaire était beaucoup moins avancée qu’aujourd’hui. »
Pas de traitement de faveur donc. Toutefois, il faut bien reconnaître que l’industrie, après avoir dépensé des efforts importants, s’est « essoufflée » sur la question du VIH. « Notre modèle économique est basé sur le fait que l’industrie pharmaceutique développe des vaccins et nouvelles molécules grâce aux bénéfices qu’elle réalise sur les médicaments ou vaccin qu’elle vend », rappelle ainsi le chercheur du CNRS.
SI nous disposons désormais de vaccins efficaces contre la Covid-19, il ne faut pas désespérer qu’il en existe à l’avenir contre le Sida. Fin février, l’Inserm relayait un appel du Vaccine Research Institute, qui lançait « une campagne de recrutement de personnes volontaires pour participer à un essai de phase 1 d’un vaccin préventif contre le VIH ». Celui-ci « fait appel à une technologie innovante et pourrait permettre d’obtenir un vaccin efficace qui manque à l’arsenal de lutte contre le VIH », écrit l’Institut. Jean-Daniel Lelièvre fait partie des chercheurs impliqués dans ces travaux et espère, comme ses confrères, qu’ils permettront de réaliser des avancées substantielles. Rien qu’en 2019, près de 1,7 million de nouvelles contaminations par le VIH étaient déplorées par l’OMS.