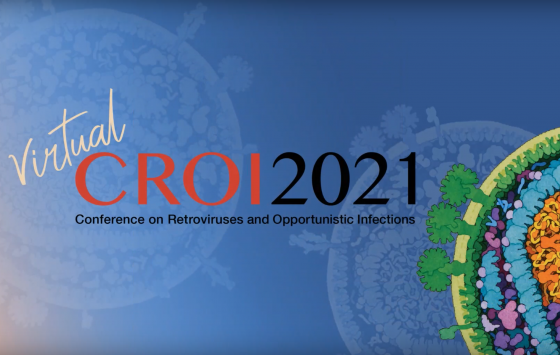Source : Seronet
Selon une projection annoncée à la Croi, d’ici 2030, un quart des personnes vivant avec le VIH aux États-Unis auront plus de 65 ans et devront faire face à plusieurs comorbidités. Nous le savons : les personnes vivant avec le VIH ne sont pas toutes égales face au virus. Il en est de même pour la Covid-19. Le genre, l’âge, l’origine sociale et ethnique et les comorbidités sont autant de facteurs qui ont une influence sur les formes sévères et la mortalité liées à la Covid-19 et sur les complications liées au vieillissement avec le VIH. C’est ce qu’ont démontré plusieurs présentations lors de cette seconde journée de la Croi 2021, en édition virtuelle.
Deux virus, mêmes inégalités
En plénière de cette seconde journée de la Croi, le Dr James Hildreth (Nashville, États-Unis) est revenu sur les ressemblances frappantes dans les inégalités en santé pour les minorités ethniques face au VIH et à la Covid-19 aux États-Unis. Dans sa présentation, l’éminent immunologiste a rappelé qu’au tout début des années 1980, le VIH/sida était identifié comme une « maladie gay » avec tous les stigmates, l’homophobie et le déni du gouvernement républicain de l’époque (les années Reagan) qui allaient avec. En 1987, année où le président Reagan a prononcé le mot « sida » pour la première fois, il y avait 60 000 personnes infectées par le VIH aux États-Unis et on comptait déjà 28 000 morts. Entre 1985 et 1995, les diagnostics en stade sida ont augmenté de façon constante dans les communautés afro-américaines et hispaniques tandis qu’ils ont diminué chez les personnes blanches. Le dépistage trop tardif du VIH et un accès inégal à la santé peuvent expliquer cette disparité. Près de 40 ans après les premiers cas de sida identifiés (juin 1981), les minorités ethniques sont toujours touchées par le VIH de façon disproportionnée. Elles représentent aujourd’hui 55 % des nouvelles infections aux États-Unis en particulier chez les hommes gays et bisexuels noirs et latinos.
Pour la Covid-19, le déni politicien a été très similaire avec le président Trump (républicain, lui aussi) qui affirmait : « Tout est sous contrôle », au moment où le nombre de cas explosait aux États-Unis. En Chine, 70 % des personnes décédées des suites de la Covid-19 avaient une comorbidité, ce qui explique une mortalité plus élevée dans les minorités ethniques américaines où la prévalence des comorbidités est plus élevée (maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, etc.), explique James Hildreth. Par ailleurs, les différences interethniques de mortalité liées à la Covid-19 sont importantes dans les États les plus pauvres des États-Unis avec, par exemple, dix fois plus de décès chez les Noirs-es comparés aux Blancs-hes dans le Michigan. « Ce n’est pas une exagération d’affirmer que la Covid-19 a été dévastatrice pour les personnes de couleur », déplore le Dr James Hildreth.
Pour lui, les facteurs clés de ces inégalités résident dans les déterminants sociaux de la santé : l’accès à l’éducation, aux soins de qualité, à un environnement de vie stable ou encore à des contacts sociaux et un statut économique. Il prend pour exemple les familles vivant dans des foyers multi générationnels avec des grands-parents qui vivent avec leurs enfants et petits-enfants dans des espaces exigus et qui sont très exposés à une forme sévère de la Covid-19 ou encore la surpopulation en prison où le taux de personnes noires et hispaniques incarcérées est largement supérieur.
L’immunologue poursuit sa présentation sur la sous-représentation des médecins noirs (5 % aujourd’hui alors que les personnes noires représentent 13 % de la population américaine) et la sous-dotation des médecins noirs dans les quartiers avec une forte densité de la communauté afro-américaine. « Il est nécessaire d’atteindre une équité dans l’accès aux soins en adaptant le système en faveur de ceux qui en ont le plus besoin », conclue le Dr James Hildreth. Ces deux épidémies doivent servir de plaidoyer pour combler le fossé entre les différentes populations afin que chacun-e puisse être traité-e en fonction de ses besoins. Pour cela, il faut une coordination entre les différentes institutions publiques.
=> Pour lire la suite de l’article, se rendre sur : Seronet