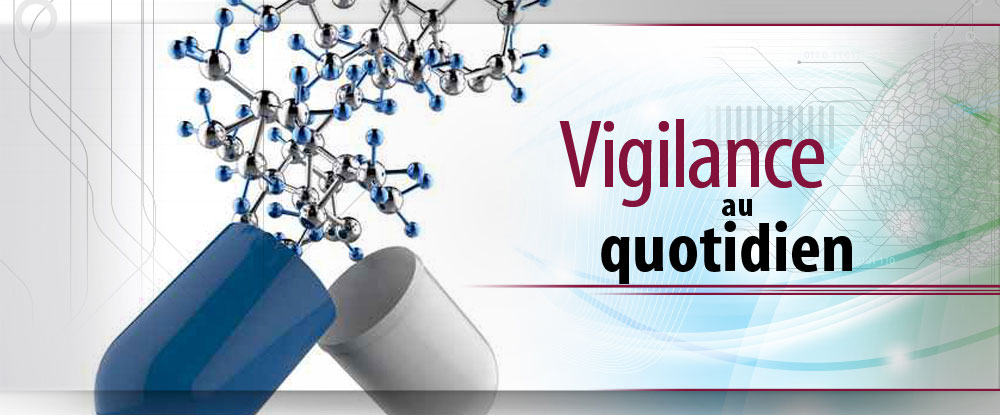Source : medscape.com
Paris, France — Est-il possible d’en finir avec le SIDA au cours de la prochaine décennie ?
C’est l’objectif que s’est fixé l’Organisation Mondiale de la Santé et ONU-sida pour 2030. Cela nécessite un dépistage efficace de l’infection par le VIH, un accès universel aux traitements et une prévention ciblée. De nombreux outils existent, mais comment faire en sorte de coordonner les actions ? C’est à ces questions qu’a tenté de répondre Eve Plenel, coordinatrice de Vers Paris sans sida, lors de son intervention au Congrès de la Médecine Générale France, en se focalisant sur l’épidémie parisienne dans le milieu gay qui concentre à elle seule 10% de l’épidémie nationale [1].
Une épidémie stable et concentrée
Avec 6 000 nouveaux cas chaque année en France, parmi lesquels 2 600 (44%) en 2016 étaient chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), l’épidémie est considérée comme stable. Elle est aussi concentrée d’un point de vue démographique et territorial puisque l’Île-de-France recouvre quasiment la moitié des nouvelles découvertes de séropositivité. « Le taux de découverte de séropositivité par million d’habitants est 4 fois plus élevé en Île-de-France que sur le territoire national, et 8 fois élevé si l’on considère Paris intra-muros » a indiqué Eve Plenel.
Autre façon dire les choses, les homosexuels parisiens représentent 11% des nouvelles découvertes de séropositivité en France pour 2016. « Donc, si on arrive à mettre un terme à l’épidémie intracommunautaire à Paris chez les gays, on arrive à bout de 10% de l’épidémie nationale » a considéré l’oratrice.
« Ce qui fait que cette épidémie perdure, ce sont principalement les cas non diagnostiqués. On sait en effet qu’une fois diagnostiquées, les personnes entrent rapidement dans le soin et ont accès aux traitements qui sont un gage de non transmission secondaire du virus ». Atteindre les personnes non diagnostiquées est donc un enjeu majeur de la lutte contre l’épidémie, sachant qu’on estime à environ 25 000 personnes, le nombre de personnes qui vivent avec le VIH en France sans le savoir, dont 10 000 en Île-de-France et 4 000 à Paris.
Pour Eve Plenel : « l’infection non diagnostiquée n’est pas un stock mais un flux lié au trop long délai entre l’infection et le diagnostic ». Et si l’on fait mieux chez les homosexuels masculins/HSH que dans d’autres groupes de population, le délai reste tout de même très long avec 2,9 années en moyenne, et des diagnostics tardifs (<350 CD4/mm3) pour 32% d’entre eux.
Population très mal identifiée, voire « invisible », les HSH – à savoir, dans 80% des cas des hétérosexuels, souvent mariés, pères de famille et en couple – représentent 39% de l’épidémie non diagnostiquée. Ils constituent une catégorie hétéroclite de « personnes qui ne sont pas touchées par les réseaux habituels de prévention et de dépistage, et ne s’identifient pas aux campagnes de sensibilisation existantes » comme l’expliquait en 2014, Sandrine Fournier, responsable des programmes Prévention gay (Sidaction). D’ailleurs, 26% des HSH ayant découvert leur séropositivité en 2016 ont déclaré ne jamais avoir été testés auparavant.
C’est la raison pour laquelle, début 2017, la Haute Autorité de Santé a fait évoluer ses recommandations , préconisait désormais de dépister les HSH tous les 3 mois – et non plus tous les ans – en raison d’un risque d’infection 200 fois plus important.
Une personne séropositive ne transmet plus le virus si elle est traitée
Endiguer l’épidémie repose essentiellement le dépistage, la prophylaxie et le soin. « Pour banaliser le test, et en faire un outil simple, informatif et accessible, il faut faire passer quelques informations, considère Eve Plenel. La première étant que lorsqu’on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH – un constat publié dans la littérature depuis 2009 et validé définitivement en 2016 par une vaste étude multicentrique qui a documenté près de 90 000 rapports sexuels entre couples différents homosexuels et hétérosexuels [3].
On peut être séronégatif et le rester
Deuxième message : un homme séronégatif peut aujourd’hui le rester. Outre le préservatif, un homme séronégatif qui a des rapports sexuels avec d’autres hommes dispose de la Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP), traitement prophylactique contre le VIH, avec 2 schémas de prise, soit continue (1 comprimé par jour), soit discontinue (liée aux rapports sexuels). Recommandée par l’OMS depuis 2015, elle est disponible en France et remboursée à 100 % depuis 2015 (dans le cadre d’une RTU) et depuis 2016 pour tous. Alors que le nombre de personnes sous traitement prophylactique était de plus de 5000 au 31 juillet 2017, on est aujourd’hui autour de 8000 à 9000 personnes sous PrEP en France – ce qui est toutefois insuffisant si on veut endiguer l’épidémie. « Les médecins généralistes ont ici un rôle à jouer car ils peuvent renouveler la prescription après une première ordonnance établie en milieu hospitalier » indique la jeune femme.
Les médecins généralistes ont ici un rôle à jouer car ils peuvent renouveler la prescription après une première ordonnance établie en milieu hospitalier
Dépistage et prévention diversifiées et facilitées
Les médecins sont les premiers prescripteurs de sérologie VIH (75 % des sérologies en France) mais ont aussi la possibilité d’orienter les patients vers les centres de dépistages (CeGIDD), les associations qui réalisent les tests rapides ou les pharmacies pour un autotest VIH. On compte aujourd’hui 81 tests réalisés pour 1000 habitants, dont la répartition est la suivante :
Laboratoire de ville : le plus souvent suite à une prescription médicale. 2 sérologies positives pour 1000. Test : Elisa de 4ème génération.
CeGIDD : 6 % des tests ; 3,5 tests positifs pour 1000. Test : TROD ou Elisa.
TROD communautaires : 56 000 TROD dont 30% chez les HSH ; 8,7 tests positifs pour 1000 TROD réalisés.
Autotest VIH : 75 000 vendus en 2016 malgré un coût élevé.
Comment soutenir les médecins généralistes acteurs de la fin du sida ?
Au-delà de la prescription de sérologie de dépistage, du renouvellement de la PrEP, et du suivi de l’infection – que la chronicisation de l’infection à VIH et la simplification des traitements ont favorisé –, que peut faire le médecin dans le contexte extrêmement contraint de la médecine générale dans l’optique « zéro nouvelle infection en 2030 » ? Eve Plenel a donné plusieurs pistes.
Tout d’abord, banaliser la question « avez-vous eu des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels depuis la dernière qu’on s’est vu ? » ; « des femmes, des hommes ?…. ». Les patients ne mentent pas quand ils comprennent qu’elle est posée pour améliorer leur santé (voir encadré ci-dessous).
Ensuite, discriminer – dans le bon sens du terme – les gays/HSH sur la fréquence de prescription du test VIH qui doit devenir un examen de routine au même titre que le frottis chez les femmes ou la vaccination contre la grippe chez les plus de 50 ans.
Ne pas passer à côté des symptômes évocateurs de primo-infection, ou d’une autre IST, quel que soit le cadre de vie supposé de la personne.
Prendre la réalité des sexualités et des désirs comme elle est…
L’orientation sexuelle des patients reste taboue
Difficile pour un patient de confier à son médecin ses préférences en matière de sexualité et de genre. Car les médecins, qui souvent manquent de formation sur le sujet, sont gênés ou ne se sentent pas habilités à poser la question (pour des raisons de pudeur, de respect de l’intimité, etc). C’est ce qui ressort de la thèse soutenue fin 2016 par Thibaut Jedrzejewski.
Dans son enquête EGaLe-MG (« enquête gay, lesbienne – médecine générale ») – l’une des premières du genre –, le jeune médecin parisien montre que parmi les hommes ayant répondu à son questionnaire (n=1158), 40,5% n’ont jamais parlé de leur orientation sexuelle avec leur médecin traitant et 78,8% déclarent que le médecin ne leur a jamais posé la question. Pour les femmes (n=1159), les chiffres sont de 48,7% et 81,4% respectivement. Et pourtant, «les personnes mentent très peu quand on leur pose la question. Elles sont même plutôt ouvertes à en parler si l’initiative ne vient pas d’elles mais du médecin», a précisé le Dr Jedrzejewski lors de sa présentation au CMGF [1].
Pour ce dernier, les médecins généralistes ne sont pas suffisamment au courant de l’orientation sexuelle des patients, ce qui ne leur permet pas toujours d’adapter la prise en charge, en termes de prévention (sur les infections sexuellement transmissibles (IST) par exemple, ou les vaccins) et de soins aux spécificités des patients gays et lesbiennes – qui souhaitent, par ailleurs être « traités comme tout le monde » [1].